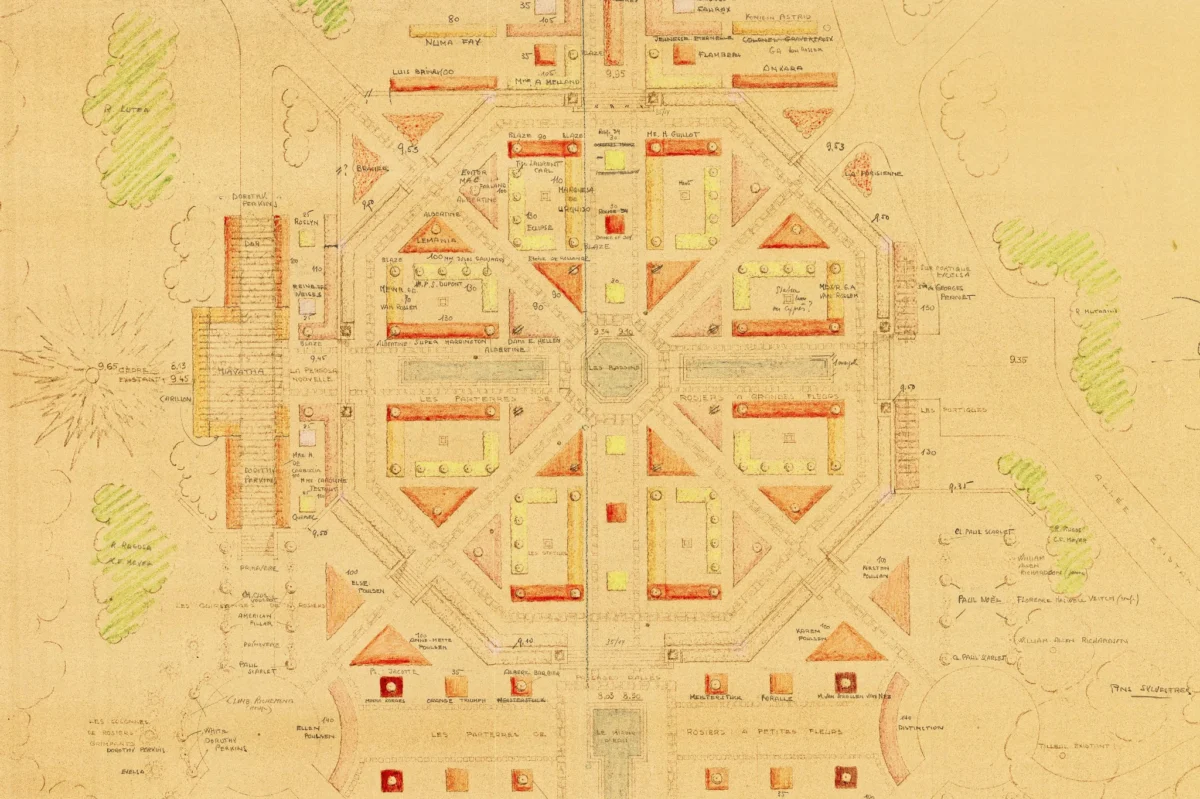Le patrimoine technique comme mémoire vivante
Matérialité et immatérialité au Musée international d’horlogerie
Par Régis Huguenin, conservateur du Musée international d’horlogerie
Bulletin 2/2025 – Industriekultur, 17. Juni 2025Au-delà des objets, le Musée international d’horlogerie est un lieu où les savoir-faire s’exposent. Par la restauration, la formation et le dialogue avec les artisans, il joue un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de la mécanique horlogère, inscrite à l’UNESCO depuis 2020.

Horlogère-restauratrice du Musée international d’horlogerie. © Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz
Lors de l’ouverture des portes de l’Ecole d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds en 1865, mission était donnée aux professeurs de constituer une collection, ceci avant tout dans un but didactique. Durant 35 ans, horloges, montres, mouvements se collectionnent et s’exposent aux seuls regards des élèves et des professeurs. Le 24 mars 1902, les autorités de la Ville de La Chaux-de-Fonds signent l’acte de fondation du Musée d’horlogerie. Une salle est dédiée au musée dans les locaux mêmes de l’Ecole d’horlogerie. C’est à cette date qu’entre dans les collections le grand chronomètre de marine n°12 de Ferdinand Berthoud, pièce exceptionnelle datant de 1774.
Une période faste commence pour l’institution après la Seconde Guerre mondiale : de superbes montres émaillées sont acquises, certaines provenant de la vente de la collection du Roi Farouk en 1954 comme la magnifique montre à tact signée Abraham-Louis Breguet datant des environs de 1800.
Au début des années 1960, le besoin d’un nouveau bâtiment susceptible d’accueillir le musée est de plus en plus marqué. En 1963, le professeur Georges-Henri Rivière, alors directeur du Conseil international des musées (ICOM) à Paris, est chargé par le Conseil communal d’une étude sur les collections des musées de la Ville. Le rapport met en évidence l’importance majeure de la collection du Musée d’horlogerie et insiste sur la nécessité de nouveaux espaces pour la présenter. La Fondation Maurice Favre est créée en 1967 dans le but de recueillir une partie importante des fonds nécessaires à la construction d’un nouveau bâtiment.

En 1968, le musée prend le nom de Musée international d’horlogerie (MIH) et en sous-titre « L’Homme et le Temps ». Un concours d’architecture est lancé pour la construction d’un nouveau musée. Sur plus de trente projets, celui des architectes Pierre Zoelly et Georges-Jacques Haefeli est retenu. Les travaux débutent en 1972 pour aboutir à l’inauguration en 1974 d’un bâtiment à l’architecture d’avant-garde et en grande partie souterraine, écrin digne d’une collection unique au monde. Sans artifices, cette enveloppe fait symbiose avec le parc végétal qui l’environne par son inspiration troglodyte et immerge le visiteur dans l’univers de la mesure du temps. C’est aussi l’occasion de présenter les fresques de Hans Erni réalisées pour l’Exposition universelle de Bruxelles de 1958 et offertes au MIH par la Chambre suisse d’horlogerie.
En plus de sa collection, le Musée international d’horlogerie a la particularité d’abriter deux centres de compétences : un Centre de restauration en horlogerie ancienne et un Centre d’études interdisciplinaires du Temps, conservant une vaste bibliothèque spécialisée et plus d’une centaine de fonds d’archives.
L’enrichissement constant des collections, désormais portées à plus de 12’000 pièces, comme l’inscription, en 2020, des Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à laquelle le musée a fortement contribué, renforcent le rôle central du MIH dans le domaine de la préservation, de la recherche et de la transmission des savoir-faire. La valeur culturelle des collections patiemment constituées au fil des décennies et la qualité du projet muséal et de médiation culturelle mis en œuvre à l’intention de tous les types de publics ont récemment permis au MIH de figurer au rang des institutions mises au bénéfice d’une contribution d’exploitation de la Confédération suisse.
Des activités en phase avec le patrimoine culturel immatériel
Le patrimoine culturel ne se limite pas aux collections matérielles. De nombreuses autres composantes du patrimoine font aussi partie des missions de conservation des institutions muséales, et ce a fortiori depuis l’actualisation de la définition du musée par le Conseil international des musées (ICOM). Le patrimoine culturel immatériel comprend les traditions, les connaissances, les savoir-faire et les pratiques transmises de génération en génération et pratiquées au sein d’une communauté, d’un groupe ou par des individus. Historiquement, les musées locaux d’histoire et d’artisanat ont été en première ligne des démarches collaboratives avec des communautés. On peut ajouter à ces musées pionniers un certain nombre de musées techniques, dont plusieurs musées d’horlogerie, dont le patrimoine immatériel est souvent à la base même de leur fondation.
Les musées s’engagent à la conservation des témoignages relatifs au patrimoine vivant, mais ils peuvent également être les moteurs de la production de ce patrimoine. Cette démarche originale est rendue possible grâce à la participation des diverses communautés porteuses de ces savoir-faire. Les musées jouent un rôle de premier plan dans la dynamique de la pérennisation et de la valorisation du patrimoine vivant. Les praticiens sont sollicités pour l’identification de collections, parfois réaliser des démonstrations. Certains guides de ces institutions sont d’anciens professionnels de la branche. D’autres interviennent directement sur les collections dans le cas des horlogers restaurateurs, qui œuvrent à découvert à La Chaux-de-Fonds. Ce dialogue entretenu avec les détentrices et détenteurs du patrimoine culturel immatériel renforce la pertinence sociale du MIH.
À la conservation, à l’enregistrement et à la valorisation de ce patrimoine, les musées contribuent enfin à la formation notamment par l’éducation, par l’intermédiaire d’ateliers pédagogiques, de programmes scolaires, et de formation continues telles le récent Certificate of Advanced Studies Patrimoine horloger, dispensé par le MIH et le l’Université de Neuchâtel, s’adressant tant aux étudiantes et étudiants qu’aux professionnelles et professionels du secteur.
Les défis du renouvellement
Après un demi-siècle d’exploitation et deux millions de visiteurs, 2024, année coïncidant avec la célébration du 50e anniversaire du bâtiment, ouvre la voie à d’importants travaux de rénovation et de revalorisation du Parc des musées. Ils incluent le remplacement des installations de ventilation et la réfection de l’étanchéité de la toiture du musée, mais aussi l’ouverture d’un café des musées et une liaison directe au Musée d’histoire depuis le hall du MIH. Plus qu’un simple entretien, ces travaux consistent ainsi en la réalisation d’une vision d’avenir. Ils permettront à moyen terme une refonte muséographique, incluant la modernisation des éclairages ainsi qu’une redéfinition du parcours d’exposition et des espaces thématiques structurant la visite. La Fondation Maurice Favre et les amis MIH œuvrent de concert avec la direction, les collaboratrices et les collaborateurs du MIH pour contribuer de manière significative à ces développements par une recherche de fonds.

L’entrée souterraine du Musée international d’horlogerie dans le Parc des musées de La Chaux-de-Fonds. © MIH, J. Hoffman
L’intention du projet culturel du MIH est d’accompagner l’évolution de la société dans les problématiques et enjeux qui marqueront les prochaines décennies. Ce nouveau voyage à travers le temps, mettant en évidence les caractéristiques matérielles et immatérielles du patrimoine horloger, sera adapté aux différents publics. Il permettra de mieux mettre en valeur l’architecture du bâtiment par une scénographie harmonieuse aux atmosphères différenciées et garantissant le respect des normes de conservation préventive des objets. Plus que son caractère spectaculaire, c’est sa pertinence qui doit être soulignée, au profit d’une collection, et sublimant les vitrines originales qui continueront de former la signature du MIH, reconnaissable entre toutes.